France 2030 : L’appel à projet sur l’IA rime-t-il avec culture ?
Article publié le 15 octobre 2025
Temps de lecture : 12 minutes
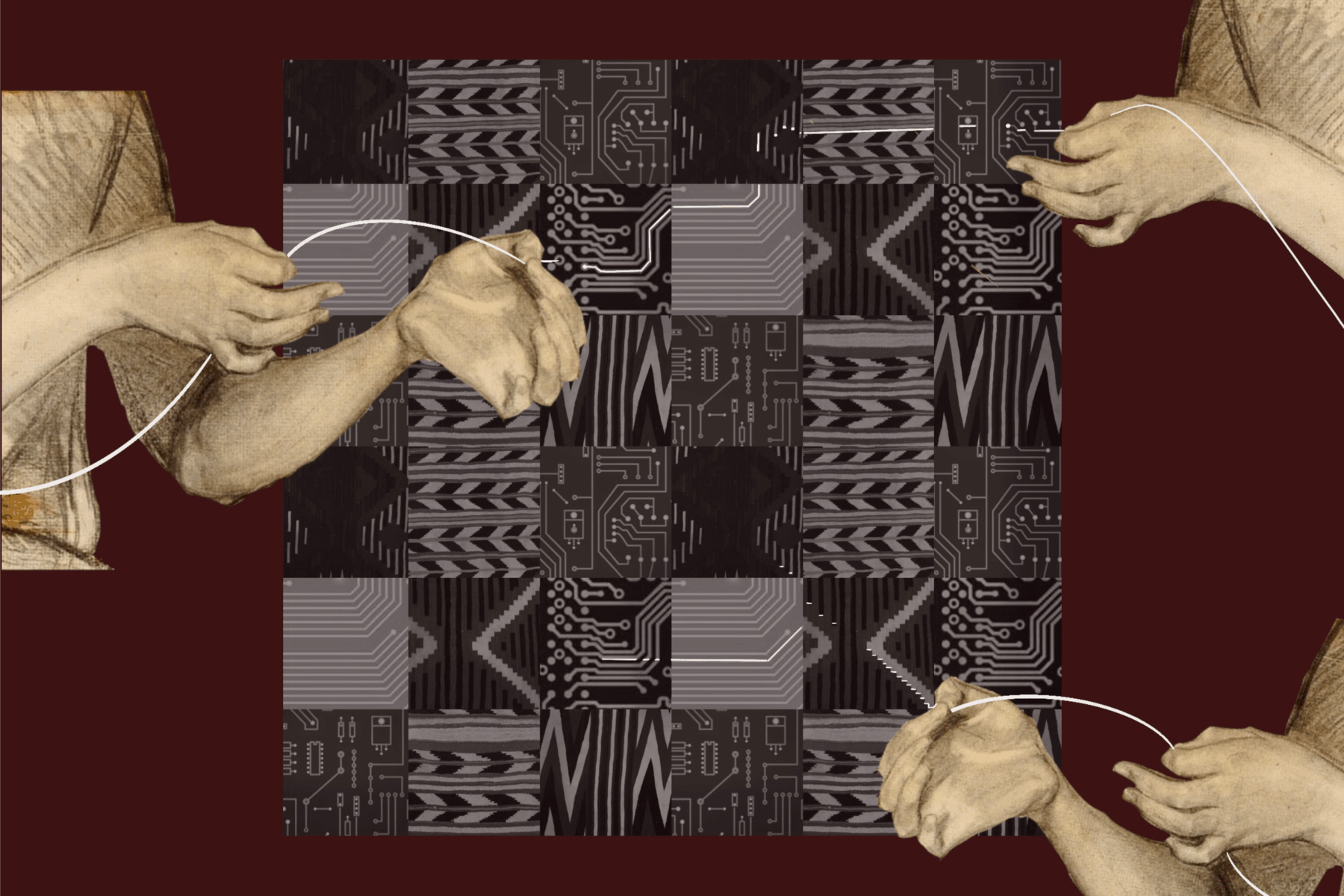
Article publié le 15 octobre 2025
Temps de lecture : 12 minutes
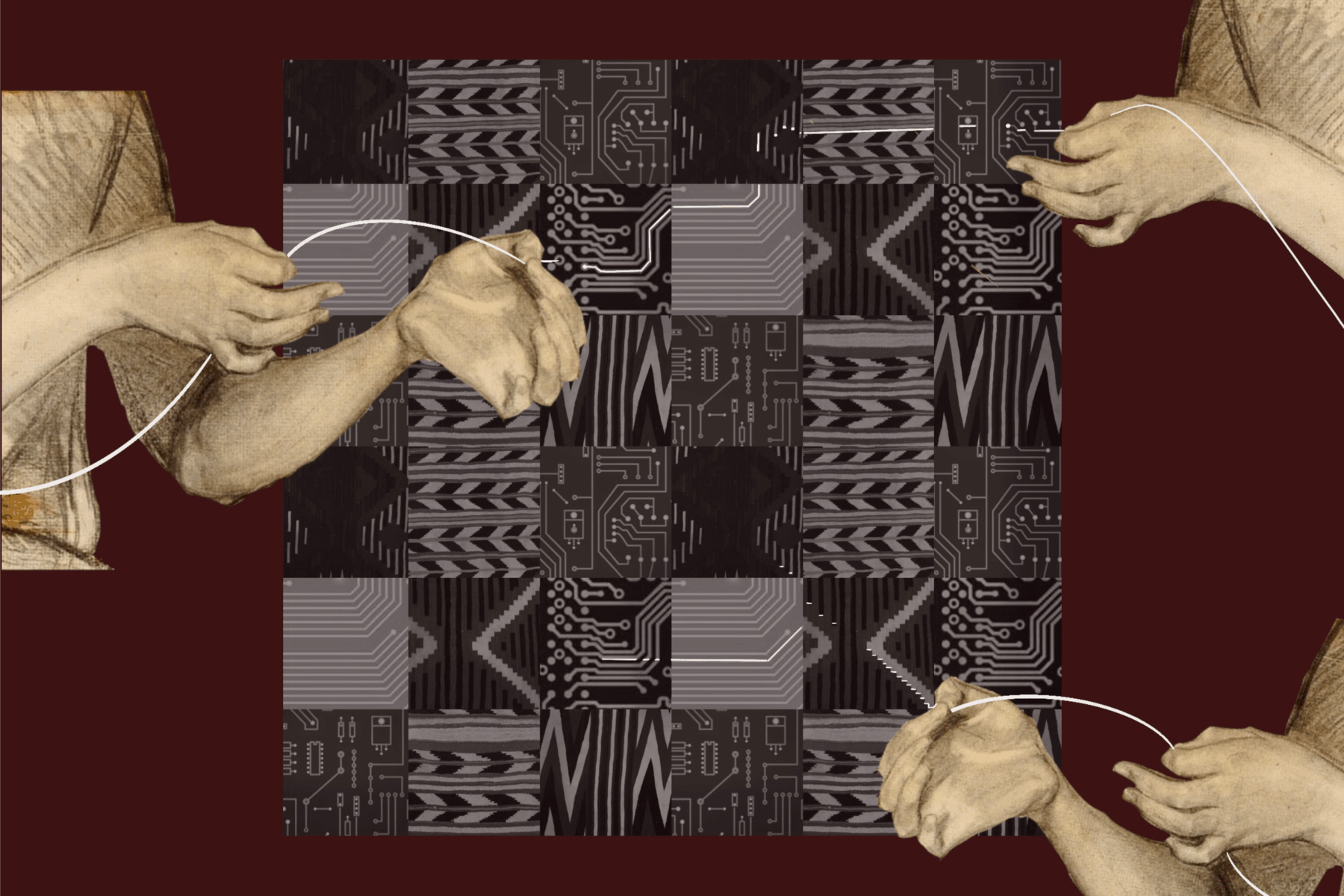
France 2030 (un milliard d’euros pour la culture) poursuit sa stratégie de soutien aux ICC françaises avec un nouvel appel à projet intitulé Transition Numérique de la Culture et Appropriation de l’Intelligence Artificielle. Une initiative qui s’adresse à tous les champs culturels et prête attention à l’ensemble des technologies, intelligence artificielle en tête de gondole. Présentation de l’AAP et mise en perspective pour les professionnel·les de la culture.
Après plusieurs AAP ciblés (Expérience Augmentée dans le Spectacle Vivant ; Numérisation du Patrimoine ou de l’Architecture ; Culture Immersive et Métavers, lire l’article Un pas en avant pour structurer la XR ?), le plan d’investissement France 2030 entend avec son nouvel AAP Transition Numérique de la Culture et Appropriation de l’Intelligence Artificielle soutenir, d’octobre 2025 à juin 2027, la transition des ICC du secteur culturel français vers le numérique. « C’est un dispositif qui vient compléter les précédents outils avec une focale beaucoup plus large », résume Fabrice Casadebaig, Coordinateur France 2030 sur le volet culture pour le Secrétariat général pour l’investissement. Plusieurs enjeux sont particulièrement de mise, et notamment celui de la démocratisation culturelle. « L’un des premiers objectifs est de porter une transition numérique qui puisse faciliter l’élargissement des publics, l’accessibilité à de nouvelles formes d’expression, à de nouvelles formes de médiation, à de nouvelles formes de relations entre les artistes, les institutions culturelles et le public », précise Fabrice Casadebaig.
Les enjeux autour de la donnée (base de données, métadonnées) sont donc centraux. La facilitation de l’échange et de la mutualisation des données avec les acteurs du marché français et du marché européen, l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données sont bien mises en avant. Ce dispositif prévoit aussi la mise en place de de tiers de confiance pour garantir la conservation et l’exploitation sécurisée des données culturelles, et anticipe des principes de lutte contre le piratage. Pour Fabrice Casadebaig, « l’innovation technologique est prioritaire » : nouveaux modèles économiques, gouvernance pérenne à des expériences actives (expériences augmentées de réalité mixte, expériences hybrides ou multicanaux mélangeant présentiel et à « distance »). « Il ne faut pas que cette innovation soit juste incrémentale par rapport à quelque chose qui se développait déjà », souligne Fabrice Casadebaig. « Il faut que cela fasse un vrai saut technologique ». Un saut oui, mais par rapport à quels indicateurs ? In fine, il semble que ce sont des enjeux de souveraineté culturelle qui pointent derrière cet AAP. Une attention particulière sera aussi portée au choix des éventuels partenaires internationaux – les solutions européennes sont ainsi encouragées, même si le financement ne portera que sur les parties françaises des projets – ou des composants logiciels.
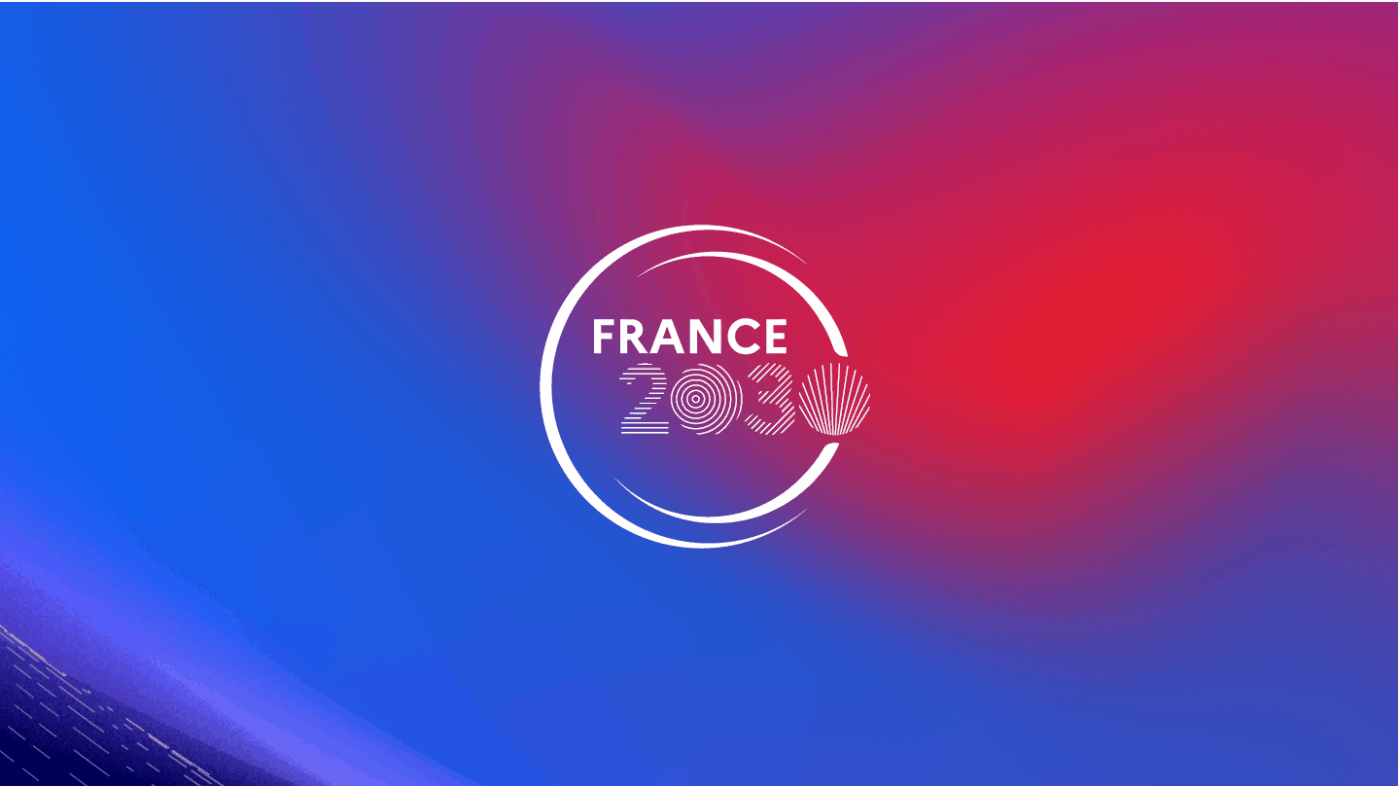
Enfin, même si elle ne bénéficie pas d’une exclusivité dans cet AAP, un point particulier sera porté à l’IA, puisqu’il s’agit d’un « domaine de création central et stratégique ». L’approche des projets retenus sera très attentive à leur cadre juridique et de valeurs. Fabrice Casadebaig évoque l’actuel cycle de concertations en cours, à la demande de la ministre de la culture et de la ministre déléguée à l’IA et au numérique, entre développeurs de modèles d’IA génératives et ayants-droits. « Est-ce qu’il y a des ressources humaines dédiées ? Est-ce que le règlement européen sur l’IA est respecté ? Est-ce que l’approche sur les droits d’auteur l’est également ? Nous regarderons ça de manière très rigoureuse afin de conforter le modèle français du droit d’auteur et des droits voisins, et de voir comment l’ensemble des nouvelles technologies – pas que l’IA d’ailleurs, mais aussi la blockchain par exemple – peuvent nous aider à mieux tracer les contrefaçons en ligne, à débusquer les utilisations frauduleuses et les réutilisations non autorisées, à accélérer la remontée des droits vers les titulaires, à améliorer la reconnaissance et la traçabilité des œuvres et des contenus, à expérimenter des nouveaux modes de partage de la valeur avec l’IA générative ».
Antérieure à la publication de cet AAP, l’article publié par Grégory Chatonsky en février dernier s’inquiétait assez justement des politiques d’investissement du hardware actuellement menées – et de leurs résonances environnementales – dans le cadre du développement de l’IA. L’artiste français y stipulait notamment qu’« au lieu d’investir massivement dans les infrastructures, la France pourrait développer un écosystème favorisant l’expérimentation sociale et culturelle (qui) passerait par la création de résidences d’artistes-chercheurs en IA, le soutien à des projets expérimentaux à échelle humaine, et le développement de formations hybrides mêlant art et technologie, (et qui) permettrait également d’investir dans la recherche fondamentale sur des modèles d’IA plus efficients et écologiquement responsables. » L’AAP semble lui répondre en partie, en mettant en avant des logiques de processus immatériel – et pas seulement d’actifs matériels – très en amont dans la conception, même si l’optique générale est plus celle d’une stratégie industrielle que le principe d’une primauté laissée aux artistes-chercheurs. « Nous ne sommes pas ici dans une logique de création de contenus culturels », tient à rappeler Fabrice Casadebaig même si l’idée de la tribune de Grégory Chatonsky visait bien entendu plus large par son idée d’écosystème, « ni dans un dispositif de soutien à la recherche fondamentale. Mais au-delà des actifs matériels [ndlr : hardware, infrastructures, dépenses de sous-traitance, d’études, d’ingénieries de personnel, ou encore dépenses techniques pour réduire l’empreinte carbone], l’idée est aussi de trouver de nouvelles procédures, de nouvelles modalités pour obtenir un résultat qui s’obtenait auparavant de manière plus longue, plus coûteuse sur le plan économique mais aussi environnemental, et qui serait donc moins cher, moins carboné et plus rapide. »
Or ce postulat mérite d’être discuté. Il repose d’abord sur l’idée que le processus de production d’une œuvre pourrait être accéléré, voire automatisé. Cette croyance du “better, faster, stronger” est pourtant largement contredite par la pratique des artistes. Prenons un exemple : Justine Emard rappelait dans notre article Les effets du dataset que, si « l’entraînement d’un modèle peut durer quelques heures, les phases en amont et en aval s’étendent sur plusieurs mois. Il faut aussi prendre le temps de visionner des centaines d’images générées. C’est un processus en strates, qui n’a rien d’instantané, à l’opposé du prompt qui, lui, produit immédiatement une image. » Ensuite, établir un lien direct entre technologie et réduction de l’impact environnemental relève d’un techno-solutionnisme simpliste. L’histoire des technologies montre au contraire que l’augmentation de la productivité entraîne systématiquement une augmentation de la production et donc, mécaniquement, une hausse de l’empreinte carbone.
Dans cet AAP, la création d’œuvre directe n’est pas soutenue. Sauf pour la démonstration (pilote) d’un nouveau procédé de production ou de diffusion qui peut être prise en charge, dans la limite du cinquième du projet global d’investissement. Fabrice Casadebaig tient malgré tout à mettre en avant l’intérêt majeur de l’AAP pour les projets – hors créations de contenus donc – encourageant les collaborations entres artistes et techniciens porteurs de solutions technologiques, toujours dans l’idée de modéliser une nouvelle production culturelle et de soutenir significativement les leviers de transformation de la filière ICC. « C’est tout l’objet de nos AAP », rappelle-t-il. « Un artiste qui voudrait déployer une nouvelle démarche avec de nouvelles modalités d’approche ou d’échange pourrait ainsi être accompagné. » Une association entre artistes et start-ups qui pourrait effectivement mettre en place quelque chose de radicalement nouveau, mais qui passe tout de même par un solide montage de projets en termes financiers. La constitution de consortiums, privés ou publics/privés, est ainsi mise en avant, avec une assiette de dépense éligible d’un minimum de 400 000 euros, histoire de signifier l’ambition attendue des projets, et une part de subvention qui sera de 60 % au maximum quand la part d’avances remboursables sera de 40 % au minimum. « Nous n’attendons pas forcément que des grandes entreprises, mais il faut une variété d’acteurs qui soient effectivement solides », confirme Fabrice Casadebaig.
Parmi les structures candidates à cet AAP, le projet The Feral vise à créer une IA Sensible, capable d’apprendre de son environnement naturel (capteurs son, image et vidéo disséminés sur le site, lire l’article créer avec l’IA : des alternatives écologiques existent) et de l’intervention des artistes, des chercheurs et du grand public. Une IA éthique, souveraine et responsable qui serait située en ruralité, assurant la création d’œuvres collectives avec les publics sous le regard de caméras agissant comme autant de supports d’apprentissage pour une intelligence artificielle en phase avec son environnement. Pour Fabio Trotabas, porte-voix du projet, cet AAP représente « une opportunité rare de pouvoir réaliser les investissements technologiques indispensables, comprenant les ressources humaines nécessaires à la construction de notre modèle d’IA Sensible (architectes, ingénieurs, chercheurs, artistes, chargé·es de projet…), mais aussi les travaux et le matériel nécessaires : les capteurs sensibles (matériel audiovisuel, caméras, micros, éclairages) ; la puissance de calcul et le stockage des données (CPU/GPU, data center, serveurs et dispositifs de cybersécurité) ; l’alimentation énergétique autonome (panneaux solaires et dispositif de géothermie) ; le traitement et la modélisation des données (ordinateurs, logiciels) ; la gestion des flux d’information (fibre optique et connectiques) ». Cet AAP lui semble idéal pour contribuer, à l’échelle d’un projet comme The Feral, à une structuration numérique et responsable de la filière des ICC. « Nous souhaitons améliorer les modèles d’intelligence artificielle actuels (IA générative, LLM, Agent IA) pour qu’ils puissent être entraînés à partir de contenus culturels francophones, qu’ils respectent davantage les droits d’auteur (par le biais de contrats de partenariat éthiques – smart contracts inscrits sur la blockchain – afin d’éviter le pillage et valoriser l’utilisation des données par des tiers), avec des données stockées et exploitées de manière responsable en France, et surtout des nouveaux modèles qui proposent des réponses de qualité au regard des enjeux culturels, comme une sorte d’IA curatée », complète-t-il.

Comme pour les précédents AAP, la plateforme de BPI France reste le lieu central de renseignement et de dépôt des dossiers. Rappelons que quatre sessions de dépôts sont prévues, la première étant fixée au 28 octobre 2025, la dernière au 16 juin 2027. Comme précédemment également, les projets seront jugés par un jury composé d’experts indépendants, mais cette fois encore plus large, puisque couvrant tous les champs de la culture, avec des spécialistes du numérique, des questions d’environnement, du financement, de la diffusion… Concernant les dossiers qui seront déposés, Fabrice Casadebaig fait confiance aux acteur·rices et porteur·euses. « Nous aimons penser que nous allons nous laisser surprendre par la qualité des dossiers. », plaide-t-il. « C’est pour cela que nous ne donnons pas forcément une direction vers laquelle aller – comme l’IA par exemple – plutôt qu’une autre. Le secteur sera sans doute plus créatif qu’on ne peut l’être nous-mêmes quant aux types de solutions apportées qu’on nous présentera. »
Futur·es candidat·es, voici quelques conseils :
✔️ Être synthétique dans la présentation. « Souvent, les dossiers trop verbeux sonnent creux », remarque-t-il. « La règle de base est « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». Il faut que l’on comprenne ce que le porteur cherche à faire, et que ce soit dit avec des mots clairs et concrets pour que les non-spécialistes du sujet puissent exactement comprendre la nature du projet et ce qui sera obtenu à la fin. »
✔️ Bien insister sur les verrous technologiques qui sont identifiés aujourd’hui et que la solution présentée permettra de lever et de dépasser. « La dimension innovante reste essentielle », affirme-t-il. « En résumé, il faut insister sur quelque chose qu’on ne sait pas faire aujourd’hui et que l’on pourra faire demain grâce à ce projet ».
✔️ Enfin, il est important que le plan du financement et le business model soient précis. « Il faut que les projets soient viables au-delà de notre financement », indique-t-il. « L’importance des cofinancements se retrouve à cette échelle. Si d’autres financeurs ont été convaincus, c’est bon signe. France 2030 ne donnera jamais 100 % et sera toujours dans une logique de cofinancement, même si cette logique est vue de manière large, et qu’il ne s’agit pas forcément de cash, mais peut-être de mise à disposition de ressources humaines, de matériel ou autre. Il ne s’agit pas d’un guichet de financement unique. »
Laurent Catala