L’usage massif des données par les plateformes : retour de la critique matérialiste de l’industrie culturelle ?
Article publié le 16 septembre 2025
Temps de lecture : 18 minutes
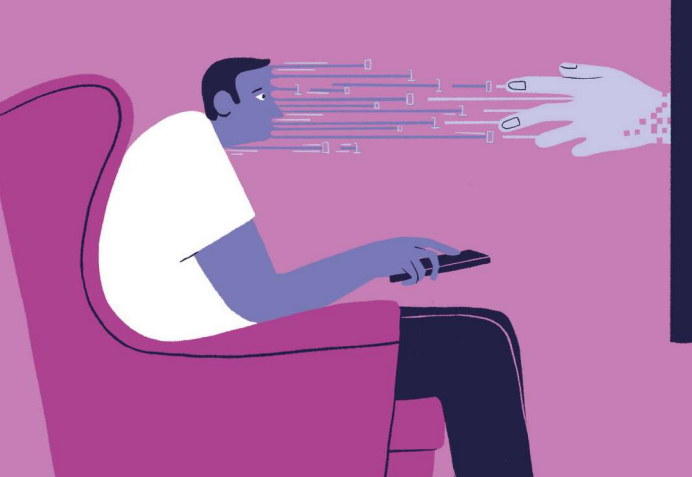
Article publié le 16 septembre 2025
Temps de lecture : 18 minutes
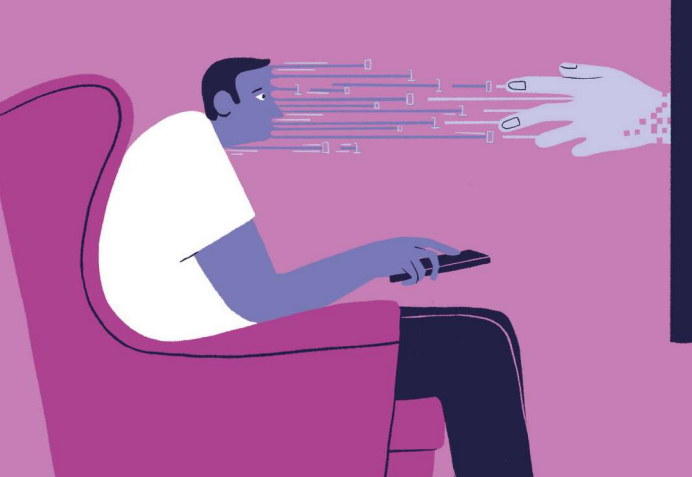
Cet article est paru il y a quelques mois dans les pages de notre partenaire NECTART. Pourquoi republier cet article ? Car nous pensons qu’il permet de prendre du recul sur les effets de plateformisation et de mieux analyser les impacts d’aujourd’hui. On y parle de données, d’économie de l’attention, d’algorithmes d’apprentissage automatique ou d’IA…
Dès les années 1920, nombre de théoriciens de l’art se sont penchés sur le devenir de nos expériences esthétiques dans un contexte d’innovations galopantes. Restée vivace dans les cénacles académiques, leur « critique » acerbe de l’« industrie culturelle » est aujourd’hui ignorée au sein du débat public, jugée par trop pessimiste, voire aristocratique. À l’heure où l’on ne s’étonne plus de l’extraction massive de nos données d’usage, le rythme confortable de la consommation de « contenus » ne mérite-t-il pas d’être à nouveau interrogé par ces élèves indisciplinés de Marx ?
Mai 2023. Une grève fait rage à Hollywood : les 11 000 syndiqués de la Writers Guild of America se relaient au piquet devant les bureaux de différents studios. Ils réclament une augmentation de salaire, une durée d’embauche et un paiement fixes pour les scénaristes impliqués dans le développement d’une série ou d’un film, ainsi que la mise en place de garde-fous afin d’éviter que leur travail ne se réduise à réécrire des textes engendrés par intelligence artificielle Cette situation rappelle que même dans le domaine onirique du divertissement américain, la réalité matérielle est première : la production suppose le travail, et donc la discussion sur les conditions qui le déterminent.
L’autorité de la réalité matérielle, c’est-à-dire l’épreuve du monde par le corps, s’est trouvée d’emblée au cœur des préoccupations de la tradition marxienne. Dans Le Capital, Marx fait déjà de la souffrance, et particulièrement de « l’énorme mortalité des enfants d’ouvriers pendant leurs premières années d’existence2 », la base de sa critique du capitalisme, et s’appuie sur différents rapports, médicaux ou administratifs, pour étayer son argument. De son enquête soucieuse du terrain, le philosophe allemand conclut néanmoins une prémisse plus large : étant entendu que la douleur possède une charge symbolique forte, donc qu’elle impacte, si elle est montrée, la conscience, la classe qui en dépend pour maintenir son statut œuvrera toujours à la nier ou la minimiser. Depuis lors, la gauche politique n’a cessé de se battre afin que la vérité de l’exploitation triomphe du mensonge idéologique qui la dissimule.
On comprend aisément en quoi le secteur de la culture est d’importance au sein de cette lutte. Walter Benjamin, auteur communiste de la première moitié du xxe siècle, conclut dès les années 1930 que le cinéma recèle la possibilité de rendre intelligible la catastrophe sociale afin de façonner une conscience collective révolutionnaire. Son ami Siegfried Kracauer, figure incontournable de la critique cinématographique, estime quant à lui qu’on doit toujours s’attacher à se rapprocher de la concrétude des choses, seule capable de s’opposer aux abstractions technocratiques qui polluent la modernité. « Comment parvenir jusqu’à ce monde d’en bas ? » demande-t-il en 1960, pour aussitôt répondre : « Incontestablement, la tâche nous est considérablement facilitée par la photographie et par le film qui non seulement isolent les données matérielles, mais trouvent dans la représentation qu’ils en donnent leur plein aboutissement »3. Pour Kracauer, le réel est fait pour la caméra, et la caméra pour le réel, si bien qu’il parle de caméra-réalité pour décrire le caractère intrinsèquement cinématographique du quotidien. Du Sang des bêtes (Georges Franju, 1949), qui dévoile sans détour l’univers d’un abattoir parisien, au récent Balai libéré (Coline Grando, 2023), qui retrace l’audacieuse création d’une coopérative de nettoyage par les femmes de ménage d’une université belge, cet esprit matérialiste, porté dans le champ philosophique par l’École de Francfort4, n’a cessé d’imprégner l’histoire du cinéma.
Ces réflexions s’ancrent dans une forme d’optimisme originel à l’égard des expériences esthétiques médiées par des œuvres poignantes. De telles expériences sont en effet intrinsèquement contestataires en ce qu’elles rompent avec ce que nous vivons au jour le jour : la domination par le travail aliéné. La bifurcation induite par l’art peut se manifester de différentes façons, mais c’est peut-être Herbert Marcuse, régulièrement remémoré comme le philosophe de Mai 68, qui la décrit de la façon la plus explicite : « La négation définitive du système établi serait un univers “esthétique”, “esthétique” au sens où il appartiendrait à la fois à la sensibilité et à l’art, donc la capacité de recevoir l’impression de la Forme5. » Exprimé de façon plus vernaculaire, cela signifie que l’art témoigne à la fois de la possibilité d’une vie dans le plaisir, une vie esthétisée, et de la capacité humaine à rendre une telle existence hédoniste concrète : comme l’artiste pétrit son matériau mû par une espérance utopique, les citoyens pourraient façonner une société réconciliée.
C’est à l’aune de cette vision de l’art comme lieu d’opposition au statu quo qu’on doit comprendre la formulation de la critique de l’industrie culturelle. On parle aujourd’hui d’industries culturelles au pluriel pour évoquer une réalité pratique : une multiplicité de secteurs liés à la création, qui vont du cinéma au design en passant par la musique et les jeux vidéo, sont intégrés à une économie concurrentielle de marché dont l’extension repose largement sur l’innovation technique. Le concept est devenu descriptif : il désigne un état de fait, qui n’apparaît pas d’emblée comme problématique. À l’origine, le mot allemand de Kulturindustrie, canonisé en 1947 par Theodor Adorno et Max Horkheimer, les deux autorités de la première génération francfortoise, voulait pourtant faire scandale. La culture, comprise comme l’expression élevée d’une population consciente d’elle-même, se voyait associée à la brutale reproduction des marchandises standardisées. L’être humain apprenait que les individus ne se penseraient désormais plus à travers leurs peintures, poèmes et symphonies, mais au moyen d’enseignes publicitaires.
L’angoisse que devait provoquer l’évocation d’une culture engendrée à échelle industrielle renvoie à ce que nous pouvons éprouver lorsqu’il nous est annoncé que l’IA sait désormais s’entraîner en analysant des créations qu’elle a elle-même produites. L’enjeu n’est pas tant de voir une capacité humaine soudain désacralisée par la machine, que d’anticiper une forme d’aplatissement statistique de l’imagination. Dans le cadre des grèves à Hollywood, David Simon, créateur de la série The Wire, déclarait : « Si vous pensez à ce qui fait la télévision et les films, ce qui les a faits et ce qui les fera, c’est l’histoire, c’est le récit. Et cela commence avec le scénariste. […] Le travail dérivé [de l’IA] ne va jamais ouvrir de nouvelles voies6. » Si le principe de l’industrie est la reproduction du même, et si l’art devient son objet, que reste-t-il de la charge subversive propre à l’esthétique ? Réponse d’Adorno et Horkheimer : elle s’affadit inévitablement. L’œuvre qui ne fait qu’imiter celle qui l’a précédée pour en reproduire le succès commercial exprime ce qui fonctionne en l’état, et en aucun cas les possibilités sensuelles réprimées qui pourraient nourrir la révolte. C’est pourquoi les auteurs de La Dialectique de la raison constatent, dans une rhétorique apocalyptique qui les caractérise, que l’automatisation a pris « le pouvoir sur l’homme durant son temps libre et sur son bonheur », et détermine « si profondément la fabrication servant au divertissement que cet homme ne peut plus appréhender autre chose que la copie »7.
Dans un essai devenu classique, intitulé Théorie traditionnelle et théorie critique, Max Horkheimer avertissait contre l’ambition de vouloir figer des diagnostics établis. Si l’être humain est toujours historiquement situé, et porte par conséquent le devoir de penser en dialogue avec le temps présent, il a symétriquement l’obligation de ne pas confondre les époques. Ainsi la théorie critique, dont nous nous revendiquons ici, doit-elle être essentiellement dynamique : « Pour une véritable pensée critique, la clarification ne peut être seulement un processus logique, elle doit se faire tout autant dans le domaine concret de l’histoire. Lorsqu’elle a lieu, elle provoque un changement aussi bien dans l’ensemble de la structure sociale que dans le rapport du théoricien à la société en général, c’est-à-dire que le sujet change, et aussi le rôle de la pensée8. » Un tel postulat rend problématique l’entreprise que nous nous apprêtons à mener dans la suite de ce texte : peut-on appliquer au numérique, sans trahir leur fondement méthodologique, des idées mûries dans le contexte des années 1930-1940, où le succès des propagandes fascistes côtoyait le triomphe du studio system hollywoodien ?
Faisons l’hypothèse, dans la continuité des travaux de Shoshana Zuboff, théoricienne du « capitalisme de surveillance9 », appliqués ici au domaine de l’art, que l’usage massif des données par les plateformes marque l’entrée dans une nouvelle phase des médias et industries culturelles. Avant l’avènement du big data, un marqueur général demeurait : une répartition (plus ou moins) équivalente de la connaissance – ou plutôt de l’ignorance – entre l’offre et la demande. L’aphorisme « nobody knows10 », qui signifie qu’il est impossible de prévoir ce qui fonctionnera sur le marché, s’appliquait tant au producteur qu’au consommateur : qui pouvait prédire ce qui plairait à l’avenir, même en ce qui concernait ses propres préférences ? Les données changent les règles du jeu. Désormais, les fournisseurs de services disposent d’informations colossales par rapport à ceux qui les utilisent. Le philosophe Jean-François Lyotard avait déjà établi en 1979 que la société postmoderne serait celle de l’information extériorisée en marchandise11. On préciserait aujourd’hui : de l’asymétrie d’information. Ainsi en est-il des GAFAM : « ils en savent beaucoup sur nous, mais notre accès à leur savoir est maigre12 ». Les plateformes engrangent continuellement du savoir sans qu’il soit redistribué, ce qui leur permet une maîtrise du contexte de consommation extrêmement aiguë. Par exemple, « les services de streaming qui surveillent quels films vous commencez et lesquels vous finissez, et peuvent agréger les données de millions d’abonnés à travers le monde […], en savent certainement beaucoup sur les goûts et les comportements mondiaux en matière de divertissement vidéo. Ces données peuvent aider à identifier les intérêts du public et, avec une interface utilisateur et une infrastructure technique adéquates, peuvent recommander du contenu à ceux qui sont le plus enclins à le désirer13 ». C’est désormais un truisme que d’affirmer que le savoir se situe du côté des machines. Même à échelle individuelle, dans les pratiques culturelles quotidiennes, la conviction que l’algorithme en sait plus que moi sur mes envies (qui ont le défaut d’être non transparentes et ignorantes quant à l’immensité des sources de satisfaction disponibles) s’impose14. Cette nouvelle dichotomie entre la plateforme qui sait et l’utilisateur qui ignore marque l’avènement de notre nouvel environnement d’attention.
Il doit être noté que la donnée n’est pas limitée au domaine où elle a été obtenue : associée à un objet (par exemple, un film) ou à une personne, elle donne des informations utiles dans toutes les sphères de la consommation. Une entreprise comme Disney peut en effet faire usage des données utilisateurs collectées via sa plateforme SVoD Disney+ pour prendre des décisions marketing ou de production dans ses parcs de loisirs ou son commerce de produits dérivés. La donnée acte ainsi la transformation de l’information en « forme valeur »15, en d’autres termes rend la collecte d’informations lucrative, et par conséquent justifie la numérisation de la totalité de nos pratiques. Numériser un protocole, comme par exemple lors de l’achat d’un ticket, permet en effet d’extraire des data sur une série d’interactions jusqu’alors connues des seuls acteurs. Cette nouvelle réalité informationnelle promet de créer de nouveaux monopoles dans la mesure où, en termes de loisirs, Disney voudra désormais s’occuper entièrement d’un individu-consommateur. À l’échelle des plateformes, ce nouveau paradigme a déjà pour conséquence de ramener les films et séries vers les modes de distribution possédés par les entreprises ayant encadré la production. À ce sujet, l’économiste Alain Le Diberder prophétisait en 2019 que, sous peu, « 80 % de la production des majors […] pourrait être réservée à des plateformes propriétaires et mondiales sous un régime d’exclusivité16 ».
Cette situation n’est peut-être pas tout à fait sans précédent. Aux États-Unis, durant l’âge d’or de ce studio system (1930-1949) qui coïncide avec la rédaction des théories francfortoises de l’industrie culturelle, « un oligopole contrôlait l’ensemble des étapes de la production, de la distribution et de l’exploitation17 » des films. Suite au Hollywood Antitrust Case de 1948, et dans la foulée de plusieurs interdictions (notamment celle de la pratique du block booking, qui contraignait les cinémas à acheter les films par paquets, saturant les programmations de contenus issus de la même farine18), les studios (les producteurs), ont été contraints de vendre leurs salles de cinéma, affaiblissant drastiquement leur autorité sur la distribution et l’exploitation. Or, cette séparation originelle des pouvoirs paraît aujourd’hui s’effondrer au profit d’un retour à l’« œuvre totale des effets » dont parlait Kracauer, à savoir la maîtrise par une entité déterminée (à présent, Disney, Apple, Amazon…) de notre horizon perceptif. L’exemple du conflit qui se joue actuellement autour de la chronologie des médias, un principe qui protège les exploitants des salles en leur assurant la priorité sur la diffusion des œuvres cinématographiques, est parlant. Afin de renégocier la situation française, à l’automne 2022, Disney a menacé de ne pas sortir en salles Black Panther : Wakanda Forever, l’un de ces blockbusters vitaux pour la santé économique du grand écran. Non dépendante d’exploitants extérieurs à elle-même, Disney peut donc influer politiquement à différents niveaux de la vie culturelle, actant par là même que l’autonomie des supports (salles, vidéogrammes, télévision) s’étiole. Une telle situation ne nous renvoie-t-elle pas à l’âge d’or d’Hollywood, quand les Big Five (20th Century Fox, RKO, Paramount Pictures, Warner Brothers et MGM) régnaient en maîtres sur la planète divertissement ?
Si l’on accepte que nous soyons revenus à un régime d’oligopole similaire à celui du studio system de jadis, en ce sens que le devenir d’un bien culturel se déroule désormais au sein d’une infrastructure soumise à un même propriétaire, alors la théorie critique du xxe siècle recouvre un droit de séjour, d’autant plus que, par l’intermédiaire de la donnée, le lien entre la réalité et le bien culturel s’est intensifié.
L’un des postulats les plus ancrés des théoriciens critiques est que le désir a une dimension objective : on peut le manipuler, mais son intensité dépend in fine de la vie réelle des individus. Kracauer écrit que « l’industrie du film, forcée par ses intérêts financiers, doit prédire la nature des modes qui traversent réellement la masse et ajuster ses produits à elles. […] Les audiences américaines reçoivent ce qu’Hollywood veut qu’elles exigent ; mais, sur le long terme, les désirs de l’audience déterminent le caractère des films hollywoodiens20 ». Or, capitaliser sur le désir déjà là est, depuis ses débuts, un pari de Netflix. La mécanique de recommandation qu’a développée l’entreprise quand elle proposait encore un service de location de DVD a consisté en première instance à rendre visibles les films qui lui rapportaient le plus par client, mais elle s’est vite rendu compte qu’au lieu de « partir des stocks disponibles pour influencer le consommateur, il valait mieux partir des goûts des consommateurs pour piloter les stocks21 ». Pour les plateformes actuelles, savoir réceptionner le désir est une tâche d’autant plus importante que l’abonné, nouvel archétype du pacte social, ne rembourse l’argent investi pour l’attirer (entre 40 et 120 euros en 201722) qu’après plusieurs mois de fidélité au service. C’est pourquoi le big data joue un rôle si crucial dans l’industrie culturelle contemporaine : que ce soit pour décider du prolongement d’une série ou suggérer des offres promotionnelles à une personne ayant montré des signes d’inactivité, annonçant un potentiel retrait, « les algorithmes d’apprentissage automatique aident à mieux positionner un projet ou à anticiper les réactions du public23 ». Pour s’assurer d’une loyale adhésion, les plateformes dépendent essentiellement du savoir qu’elles « emmagasinent » à propos des sentiments capables de nous mouvoir.
Une culture rythmée par une intelligence artificielle qui n’anticipe aucune évolution future mais reproduit « le passé dans le présent24 » peut certainement être condamnée pour sa nature conservatrice, au sens péjoratif du terme. L’extractivisme numérique nourrit cependant un autre phénomène plus pernicieux : la spoliation des images et récits issus de nos vies singulières. L’approche matérialiste de l’art défend la nécessité d’un retour systématique à la réalité, d’où surgit ultimement l’intensité esthétique. C’est uniquement parce qu’il y a objectivement un désir anthropologique de mettre fin à la souffrance que l’artiste s’attelle à porter sa voix, à la manière d’un François Sureau qui, lorsqu’on lui demande pourquoi il écrit, répond : « parce que quelque chose ne va pas ». Tout art semble dès lors marqué par une étrange dette à l’égard du réel : ce sont nos tribulations quotidiennes qui lui confèrent sa force symbolique. Or si l’œuvre, comme le suggère Adorno, est la « porte-parole historique de la nature opprimée, et finalement critique envers le principe du moi, agent interne de l’oppression26 », alors elle doit elle-même s’effacer, ultimement, devant l’expérience qui la justifie, donc les épreuves de la vie. C’est sans doute la raison pour laquelle les cérémonies de récompense centrées autour d’un tapis rouge nous scandalisent : le phénomène de starification qu’elles nourrissent s’apparente à un vaste détournement de la force symbolique issue de drames bien réels (la migration, la discrimination, la misère ou toute autre violence abondamment traitée dans les films sélectionnés) au profit de glorifications personnelles. En canalisant le désir qui surgit d’une soif de justice et en l’épuisant dans son propre triomphe, la star repousse toujours plus loin le temps de l’« humiliante sobriété » (Walter Benjamin) qui doit succéder à l’ivresse esthétique, à savoir la conscience du désastre. D’une certaine façon, la star devient l’unique reliquat de réalité auquel le spectateur va s’intéresser après avoir consommé un film, selon une logique que dénonçait déjà Kracauer : « La star touche le public […] en tant qu’elle est, ou paraît être, […] une personne qui existerait indépendamment de tous les rôles qu’on lui confie, dans ce monde extérieur au cinéma que le public croit être la réalité, ou qu’il se complaît à substituer à celle-ci27. »
Si l’on poursuit l’analyse dans la sphère digitale, on s’aperçoit que des plateformes comme Netflix, de leur côté, accumulent une dette encore plus profonde à l’égard du monde : non contentes d’épuiser les révoltes dans une suite ininterrompue de contenus, et répondant par là même à la devise de la classe moyenne, « s’affairer à travailler, puis s’affairer à se divertir28 », elles extraient continuellement nos données d’usage et arrachent des évaluations pour mesurer la teneur symbolique des motifs qu’elles continueront à nous exposer. Captant notre attention au profit de leur propre accroissement, sans jamais s’inquiéter d’encourager la curiosité quant aux choses concrètes, les plateformes créent l’illusion qui s’enrichit de nos actions, tout en s’abstenant bien de nous payer en retour. Kracauer estimait que l’immersion dans la rêverie ne devait être qu’un temps dans l’itinéraire du cinéphile : « Tout amateur de cinéma a pu remarquer que les phases d’absorption comme en transe alternent avec des moments où le médium perd son pouvoir de stupéfiant. […] Et à peine [le spectateur] a-t-il recouvré un état de relative conscience qu’il n’a de cesse […] d’essayer de dresser le bilan de ce qu’il éprouve29. » Cette inquiétude quant à ce qui nous arrive semble s’être définitivement noyée dans la secrète satisfaction de voir ce qui compte soudain extériorisé dans un « accès illimité30 », donc virtuellement ininterrompu, aux biens culturels. L’inspiration, le réconfort, l’amour, la joie ou la tristesse n’évoquent plus des événements existentiels, mais des « tonalités31 » associées à un produit, dédiées à l’étiquetage automatisé de fichiers et la planification de nos expériences. Fort heureusement, ce détournement de la substance de l’art sans considération pour le tragique dont il tire sa légitimité, ce pillage de nos vécus qui se contente d’« enregistrer […] les souffrances […] au lieu de les abolir32 » ne pourront se maintenir longtemps sans que l’industrie culturelle s’acquitte de ce qu’elle nous doit. L’émotion simulée ne vit en effet que du souvenir de celle véritablement éprouvée, et nous risquons, à force de chosifier le réel dans la donnée, de ne plus avoir aucun événement à nous remémorer.
Rédaction Jean-Baptiste Ghins
Notes
2. Karl Marx, Le Capital. Critique de l’économie politique, 4e éd. allemande, livre Ier, Paris, PUF, 1993, p. 447.
3. Siegfried Kracauer, Théorie du film, cité dans le mémo ci-dessous, p. 421.
4. Groupement pluridisciplinaire de penseurs fortement influencés par Marx et Freud. Constitués en école dans la foulée de la Première Guerre mondiale, ils étudièrent le capitalisme sous différents aspects, notamment en interrogeant son lien avec le fascisme, et sont à l’origine de ce qu’on nomme aujourd’hui les Cultural Studies.
5. [Nous traduisons.] Herbert Marcuse, Art and Liberation, collected papers of Herbert Marcuse, vol. 4, Londres, Routledge, 2007, p. 116.
6. [Nous traduisons.] https://bit.ly/3X83KBV
7. Theodor Adorno et Max Horkheimer, La Dialectique de la raison, cité dans le mémo ci-dessous, p. 203.
8. Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, Paris, Gallimard, 2019, p. 43.
9. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, cité dans le mémo ci-dessous.
10. Amanda D. Lotz, Media Disrupted : Surviving Pirates, Cannibals and Streaming Wars, Londres, MIT Press, 2021, chap. 4.
11. Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne [1979], Paris, Minuit, 2021, p. 14.
12. [Nous traduisons.] S. Zuboff, op. cit., p. 191.
13. [Nous traduisons.] A. D. Lotz, op. cit.
14. https://bit.ly/42IUaGC
15. J. F. Lyotard, op. cit., p. 14.
16. Alain Le Diberder, La Nouvelle Économie de l’audiovisuel, Paris, La Découverte, 2019, p. 99-100.
17. Joëlle Farchy, Le Cinéma n’est plus ce qu’il était… Mutations d’une industrie de l’imaginaire, Paris, Presses des Mines, 2022, p. 25.
20. [Nous traduisons.] Johannes von Moltke et Kristy Rawson (éd.), Siegfried Kracauer’s American Writings : Essays on Film and Popular Culture, Berkeley, University of California Press, 2012, p. 84.
21. A. Le Diberder, op. cit., p. 64.
22. Ibid., p. 95.
23. J. Farchy, op. cit., p. 57.
24. Ibid., p. 55.
25. https://cutt.ly/ewrfOurc
26. Theodor Adorno, Théorie esthétique [1970], Paris, Klincksieck, 1989, p. 311-312.
27. S. Kracauer, op. cit., p. 162.
28. J. von Moltke et K. Rawson (éd.), op. cit., p. 103.
29. S. Kracauer, op. cit., p. 254.
30. Philippe Chantepie, « L’accès illimité ou l’impossession culturelle ? », NECTART, n° 1, 2015, p. 137-146.
31. Amanda D. Lotz, Netflix and Streaming Video : The Business of Subscriber-Funded Video on Demand, Cambridge, Polity, 2022, p. 124-130.
32. T. Adorno et M. Horkheimer, op. cit., p. 224.
À lire
Theodor Adorno et Max Horkheimer, La Dialectique de la raison [1944], Paris, Gallimard, 2013.
Siegfried Kracauer, Théorie du film [1960], Paris, Flammarion, 2010.
Shoshana Zuboff, L’Âge du capitalisme de surveillance [The Age of Surveillance Capitalism, Londres, Profile Books, 2019], Paris, Zulma, 2022.