Faut-il moins produire de spectacles pour répondre à l’urgence écologique ?
Article publié le 20 janvier 2026
Temps de lecture : 16 minutes

Article publié le 20 janvier 2026
Temps de lecture : 16 minutes

Cet article est paru il y a quelques mois dans les pages de notre partenaire NECTART. Pourquoi republier cet article ? Au delà de l’écho au récent article sur l’éco diffusion publié dans notre média, nous pensons qu’il permet de prendre du recul sur un secteur des arts numériques en pleine structuration et de nous inspirer de nouvelles réflexions, parfois controversées. Ici, on parle de la naissance des industries culturelles, de son empreinte écologique, de la diffusion et des inégalités qu’elles peuvent produire..
Alors que l’urgence écologique pose la question de la production et de la diffusion des spectacles, il semble essentiel de revenir à la façon dont le théâtre s’est industrialisé depuis le xixesiècle, et a de plus en plus externalisé une partie de ses moyens de production (vial’intermittence) depuis les années 1980. Une évolution qui n’a pas exactement pris la même forme dans d’autres pays européens.
Depuis notamment la publication du rapport Décarbonons la culture !1 et la création de l’association Arviva2, les organisations professionnelles des mondes du spectacle et de la musique – et en particulier les réseaux regroupant des managers culturels – débattent des moyens de faire face aux défis écologiques. C’est par exemple le cas du Syndeac, qui dans un rapport récent3 préconise principalement à ses adhérents de rationaliser leurs activités afin de réduire leur empreinte carbone et insiste sur leur capacité à proposer de « nouveaux imaginaires ». Ayant analysé ailleurs la polarisation sur la réduction des émissions carbone4 et cette revendication des imaginaires5, je voudrais montrer ici que ce sont plutôt l’organisation et les enjeux de l’offre culturelle qui devraient être transformés. Pour ce faire, je propose d’examiner, en quatre phases, le processus par lequel le monde du spectacle s’est constitué.
Le générique du film Les Enfants du paradis (Carné et Prévert, 19456) défile devant un rideau de théâtre. Lorsque celui-ci se lève7, on découvre une foule dense circulant dans une vaste avenue bordée de théâtres : le boulevard du Crime8, ancêtre des Grands Boulevards. Nous sommes à la fin des années 1820, à Paris, pendant la Restauration (1814/1815-1830). Devant chaque édifice, des aboyeurs, mimes ou actrices tentent d’attirer le public vers le spectacle qui se déroulera bientôt. Au milieu du flot des passants qui, tel le public du festival (actuel) d’Avignon, cherchent leur bonheur, des artistes de cirque, jongleurs, dresseurs d’animaux, présentent des numéros. La caméra repère les principaux protagonistes du film dans le flux des badauds et des attractions : le mime, l’actrice, un aspirant comédien (bientôt célèbre), des truands, des rebelles. Tout au long de cette première partie, la caméra explore l’intérieur des salles de spectacle. Derrière la scène ? Les coulisses, loges, décors, costumes, rideaux de scène. Côté salle ? Les loges (et leurs intrigues) pour les plus fortunés, l’orchestre ou le paradis (où s’entassent les classes populaires) pour les autres. Pas de doute, c’est à ce moment-là que naît à Paris, mais aussi à Vienne, Berlin et Londres, cette société du spectacle, première déclinaison de l’industrie culturelle.
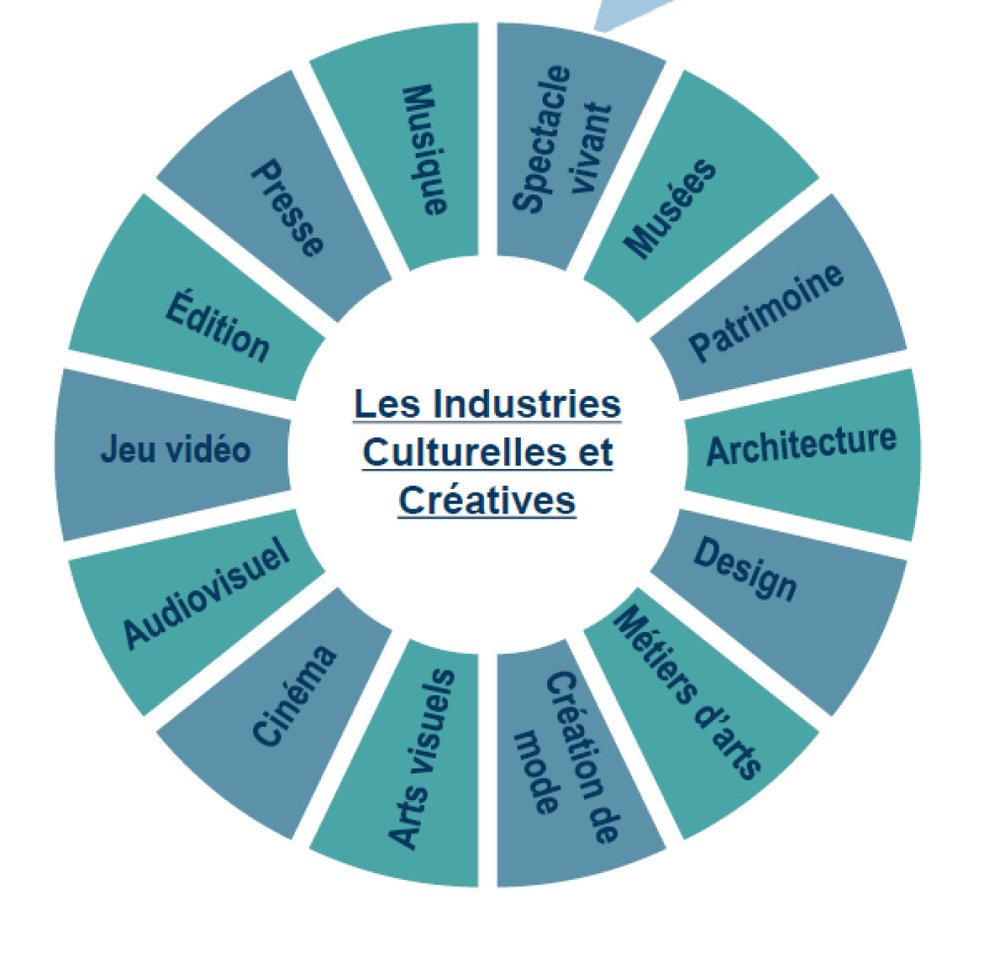
Car ces quartiers peuplés de théâtres s’apparentent effectivement à de véritables usines à spectacles. Des entrepreneurs achètent des pièces (ou des canevas) à des auteurs et/ou des éditeurs, recrutent des troupes d’artistes et de techniciens pour les interpréter. Au sein de ces entreprises, la division du travail est de plus en plus marquée entre les fonctions technique, artistique, administrative, financière et managériale (expression anachronique mais néanmoins adéquate). Une féroce concurrence règne entre entrepreneurs, entreprises, artistes et techniciens. Ces deux derniers vendent leur force de travail à des patrons sans scrupules qui, comme aujourd’hui, paient bien les vedettes et fort mal (ou pas du tout) les inconnus. Tant que le public répond présent, on continue à jouer une pièce. Lorsque le flot se tarit, on congédie tout le monde et on passe au spectacle suivant. Pour subsister et garantir leurs marges, ces entreprises/entrepreneurs font sans cesse prospérer de nouveaux produits, de nouveaux styles, de nouvelles formes. Dans cette sphère, le « théâtre » acquiert sa signification protéiforme (une manière de performer, des répertoires, des bâtiments), tout comme le « public », qui recouvre tout à la fois l’espace commun, les assemblées, les spectatrices et spectateurs. On a là aussi tous les attributs (et l’un des moments) du capitalisme : marché + force de travail mobile et exploitée + appropriation des moyens de production par des entrepreneurs + création continue de nouvelles marchandises et de besoins. C’est bien ce processus de professionnalisation de biens culturels hors-sol que l’on appelle « art »9, un monde pourtant décrit comme désintéressé et uniquement dédié à la beauté. Je veux souligner ici deux points : premièrement, c’est la structure de l’offre théâtrale qui génère ces formes de consommation ; deuxièmement, ce monde se caractérise notamment par l’essor d’un groupe social qui choisit (on dirait aujourd’hui « programme »), produit et contrôle le marché. Comme l’ont montré une série de travaux, le théâtre est la première industrie culturelle et la matrice de l’industrie cinématographique. Celle-ci lui a emprunté sa division du travail, ses compétences, ses technologies et objets, ses pratiques financières (par exemple, adapter des textes existants), ses métiers, ainsi que son leadership d’entrepreneurs/producteurs à la tête de firmes telles que Warner, Paramount ou MGM.
Dès le premier plan des Enfants du paradis, apparaît un individu chichement vêtu, sale, trimbalant un sac sur son dos. Interprété par Pierre Renoir, ce personnage malfaisant annonce de mauvaises nouvelles tout au long de l’intrigue. Il s’agit d’un chiffonnier. Aux premiers temps du capitalisme, les chiffonniers collectent et recyclent presque tout : chiffons (à partir desquels on fabrique le papier), restes de nourriture, emballages, cheveux, peaux, boues et déjections humaines et animales. Leur âge d’or coïncide avec le (court) moment où le capitalisme s’apparente à une économie circulaire10. « On ramassait, récupérait, recyclait tout, et les moindres rebuts trouvaient un nouveau destin ; tout objet rejeté gardait une valeur sur le marché de la revente ; rien ne pouvait être considéré comme hors d’usage pour de bon ; la notion de déchet n’avait pas cours ; toutes les res derelictae, ou choses abandonnées, devenaient matériaux d’une nouvelle production11. » Comme le montre Antoine Compagnon, la figure du chiffonnier est très présente dans la littérature et la poésie. Mais à partir du second Empire (1852-1870), le pouvoir limite de plus en plus leur nombre et leur périmètre. La gestion des déchets par d’autres canaux les prive de l’accès aux rebuts et les marginalise. Grâce notamment aux poubelles et à la construction d’égouts, l’hygiénisme promu sous Napoléon III invisibilise les déchets, de plus en plus nombreux et de moins en moins recyclables. Dans les égouts souterrains, l’eau est utilisée comme un véhicule. Les restes sont devenus des ordures, des déchets ; le fumier – jadis considéré comme un bien –, une puanteur. La figure malfaisante du chiffonnier des Enfants du paradis traduit peut-être cette diabolisation progressive des déchets et des humains qui s’en occupent.
Avec l’énergie fossile, le capitalisme s’affranchit de la dépendance vis-à-vis des énergies fournies par le vent, les rivières, le soleil. Il acquiert une puissance jamais atteinte auparavant et rompt avec les contraintes de la biosphère, ce qu’Alain Gras appelle « le choix du feu12 ». « Le basculement matériel de la base énergétique majoritaire d’énergies de flux vers une énergie de stock propre à la naissance d’un “capitalisme fossile” […] favorise également une profonde mutation des représentations de la nature et de la Terre13. »
À la fin du xixe siècle et plus encore au siècle suivant, l’essor conjugué des chemins de fer et du charbon accentue la délocalisation (et la transformation) des ressources et des biens. « En moins de deux cents ans, nous avons été transportés de la subsistance autonome vers l’interconnexion planétaire, de la communauté terrienne au marché mondial. Vers 1800, la plupart des Français étaient des paysans qui construisaient eux-mêmes leur maison, avec la pierre, l’argile et le bois qu’ils trouvaient sur place. Dans leurs intérieurs, peu de mobilier, de vaisselle, mais beaucoup d’outils : des faux, des marteaux, des pinces, des ustensiles tournés vers la production. Les villageois récoltaient leurs céréales, pétrissaient leur pain et tissaient leurs vêtements. Tous les objets qui habitaient un lieu y avaient été conçus. Les hommes et les choses étaient pratiquement immobiles14. »
Pour s’alimenter, se vêtir, se loger, se chauffer et – c’est un point capital ici – se cultiver, on a de plus en plus recours à des marchandises venues d’ailleurs. Et les personnes, en particulier les travailleuses et les travailleurs, sont contraintes de se déplacer pour assurer leur subsistance. La bataille contre les cultures régionales, menée tout au long des xixe et xxe siècles, consiste notamment à disqualifier le folklore au profit d’un art hors-sol et universel15. C’est dans les villes et les métropoles – l’espace même de la délocalisation et de la consommation de biens hors-sol et jetables – que la société du spectacle prospère. On l’aura compris, le boulevard du Crime et la nouvelle industrie culturelle s’inscrivent dans ce processus de délocalisation, de création de nouveaux besoins et de rupture avec la biosphère.
Les troupes de théâtre n’ont évidemment pas attendu le capitalisme pour effectuer des tournées. Mais rien de tout ce qui vient d’être mentionné n’égale l’importance, la variété, le rythme des tournées au xixe siècle. Dans un ouvrage récent consacré à la circulation des biens culturels16, Hannu Salmi répertorie les tournées européennes de Niccolò Paganini (1782-1840) et Franz Liszt (1811-1886) dans les années 1830-1840. Une cartographie en ligne17 met en évidence le vaste périmètre des tournées de ce dernier (de l’Atlantique à l’Oural), et le fait qu’il pouvait jouer plusieurs fois dans la même ville et y revenir. Salmi rappelle que l’écrivain Heinrich Heine utilisait le terme de « Lisztomania » (comme on a pu parler d’une « Beatlemania » au début des années 1960) pour rendre compte du retentissement des concerts du pianiste-compositeur dans l’espace public européen. Liszt s’insère dans le vaste marché de la musique comprenant des ensembles, des compositeurs, des éditeurs, des entrepreneurs de concerts, des agents, des facteurs d’instruments, des salles de spectacle, des salons. Grâce à la notation et à la standardisation des instruments, les œuvres éditées peuvent être simultanément interprétées dans plusieurs points du globe et générer des revenus grâce à la vente de partitions aux particuliers. Si le théâtre crée l’industrie culturelle, la musique classique est la première musique commerciale : elle délocalise et fait circuler le plus possible les œuvres et les interprètes.
Ce qui est vrai en Europe l’est aussi en Amérique du Nord. Tout au long du xixe siècle et à la faveur des infrastructures routières et ferrées, des spectacles sillonnent sans relâche les États-Unis. Le cirque Barnum, créé en 1871, transporte ses équipes, ses animations, ses freaks et ses animaux dans ses wagons, et s’appuie sur la presse locale et le télégraphe pour annoncer et promouvoir ses shows. Son fondateur installe également dès 1841 à Broadway – les Grands Boulevards new-yorkais – le Barnum’s American Museum, où se mêlent exhibitions de « sauvages » et d’humains « anormaux », spectacles et démonstrations scientifiques. Au début du xxe siècle, des agences artistiques étatsuniennes utilisent le télégraphe et les paquebots transatlantiques pour importer (et adapter) des spectacles musicaux et opératiques à Broadway.
Cette combinaison d’équipements et d’aménagements de quartiers, de circulation mondiale et d’infrastructures modernes – déjà fortement carbonées ! – s’incarne dans les expositions universelles de la seconde moitié du xixe et du début du xxe siècle. Installées à chaque fois dans une nouvelle métropole, attirant des millions de visiteurs, promouvant l’idéologie du progrès et la supériorité des sociétés occidentales et coloniales, elles présentent une multiplicité de spectacles et de concerts issus de nombreux pays18. Le fait de faire venir le public à des concentrations éphémères d’événements est également décliné dans les festivals européens de l’après-Seconde Guerre mondiale, tel celui d’Avignon où s’agglutinent les spectateurs du in et du off. Le tourisme culturel est bien l’un des innombrables visages de la globalisation et de la création de nouveaux besoins19. En résumé, le boulevard du Crime et l’intensification des tournées sont les deux faces d’une même médaille.
Au tournant des années 1960-1970, afin de contrecarrer l’influence des syndicats et des mouvements sociaux, le néolibéralisme émerge comme doctrine et pratique20. Une de ses caractéristiques majeures consiste à délocaliser la production (par le recours à une force de travail bon marché dans les pays pauvres) et à externaliser les organisations en multipliant la sous-traitance. Pour gérer tous ces flux, on crée des plateformes logistiques, on développe de plus en plus d’infrastructures de transport, énergétiques, numériques21 ; le mot « management » remplace celui de « business ». Dans la sphère culturelle, de nouveaux acteurs comme Amazon utilisent ces méthodes d’externalisation et les infrastructures de la globalisation (Web, entrepôts, livraisons) pour imposer de nouveaux modèles de consommation22.
En ce qui concerne les spectacles en Europe, le processus d’externalisation n’est pas partout identique. Prenons l’exemple de l’Allemagne. La plupart des villes (moyennes ou grandes) sont dotées de Staatstheater. Dans ces structures financées par les collectivités, on trouve le plus souvent une troupe de théâtre permanente, parfois un ballet et même un orchestre classique, ainsi que des équipes administrative et technique. On y convie aussi des artistes extérieurs, par exemple une chorégraphe ou une metteuse en scène. Les ensembles fixes interprètent des pièces du répertoire (y compris des opéras) et des créations, certains spectacles sont joués pendant des années. La plupart de ces ensembles ne tournent pas ou peu. En d’autres termes, les œuvres hors-sol (typiques de la modernité) sont interprétées par des équipes permanentes et découvertes par des spectateurs dans le territoire où ils vivent. En parallèle, l’Allemagne compte une vaste scène off (compagnies de théâtre, danse, arts de la rue, théâtre musical, humour, musique, cirque contemporain…), ainsi qu’un réseau dense de lieux (privés et/ou alternatifs) de diffusion et de production.
En France, jusqu’aux années 1960-1970, de nombreuses villes (Paris y compris) étaient dotées d’établissements de ce type. Les « grands théâtres » de Tours, Reims, Bordeaux comptaient eux aussi des troupes, des orchestres, des ensembles d’opéra, des ballets. Mais tout au long des années 1980, de nouvelles structures (scènes nationales, scènes conventionnées, centres dramatiques nationaux, centres chorégraphiques, scènes de musiques actuelles…) les ont remplacés. De plus, une profusion de festivals de toutes tailles se sont développés à tous les échelons du territoire. Comme nous l’avons montré dans La Fabrique de la programmation culturelle23, des salles de spectacle et événements, petits et moyens, sont venus s’ajouter aux établissements et festivals labellisés. La plupart sont dirigés par des managers culturels, regroupés en réseaux et en syndicats, et gérés par de petites équipes administratives et techniques fixes. Pour fonctionner au jour le jour, elles emploient des techniciens intermittents et agglomèrent des spectacles lors de trimestres (musiques actuelles), saisons (arts de la scène) et/ou festivals. Les équipes extérieures qui conçoivent, interprètent et gèrent ces spectacles programmés vendent leur force de travail sur un marché hyper-concurrentiel, il leur faut tourner le plus possible et renouveler sans cesse leurs créations. Dans ce marché où la course à (le marketing de) la nouveauté est la règle, ce sont les artistes, les équipes techniques et administratives freelance, les œuvres, les matériaux du spectacle qui incarnent l’obsolescence… programmée. De fait, le système actuel ne peut fonctionner que parce qu’il externalise – c’est-à-dire précarise et pollue – une partie essentielle de la production.
Aménager ce système – par exemple, réduire la quantité de spectacles et de professionnels/professionnelles – revient là encore à appliquer des méthodes managériales. Or, ce sont ces pratiques qui génèrent les inégalités sociales, les discriminations, les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre, les destructions des milieux, les externalités négatives et l’alimentation d’infrastructures externes toxiques (Web, réseau de transport lié aux énergies fossiles…).
Comment alors ne pas sacrifier tous les plaisirs, récits, communs, emplois, savoirs, espaces, œuvres, sociabilités qui ont surgi sur le boulevard du Crime, et qui enchantent également l’auteur de ces lignes ? Débattre démocratiquement – au-delà des seuls forums professionnels – des enjeux de « la culture » s’impose. Si la Convention citoyenne pour le climat a su établir des diagnostics et dégager des programmes d’action audacieux, pourquoi le monde culturel ne pourrait-il pas s’engager par des processus similaires ? Ne serait-ce pas là un exemple de la mobilisation de nouveaux imaginaires ?
François Ribac
sociologue et compositeur, enseignant-chercheur à l’université de Dijon, associé au laboratoire Ladyss
NOTES