Éco-conditionnalité dans la création immersive : mirage ou virage ?
Article publié le 28 octobre 2025
Temps de lecture : 12 minutes

Article publié le 28 octobre 2025
Temps de lecture : 12 minutes

Depuis le début de l’année 2025, les aides à la production du CNC pour certaines œuvres numériques sont soumises à un critère d’éco-conditionnalité, c’est-à-dire au calcul du bilan carbone d’une création. Les créations immersives sont pour l’instant exemptées de ces obligations. Même si les premières pierres sont déjà posées. Le secteur se prépare t-il à l’éco-conditionnalité ? Explication…
En 2023, le ministère de la Culture, via la Direction générale de la création artistique (DGCA), a publié un Guide d’orientation et d’inspiration pour la transition écologique, qui constitue le volet environnemental de sa stratégie “Mieux produire, mieux diffuser”. Ce guide transforme les objectifs de la politique publique en mesures concrètes, destinées à accompagner et accélérer la transformation écologique du secteur de la création artistique.
L’ambition ? A l’horizon 2027, 100% des acteurs culturels mesureront l’impact de leurs événements ou productions (source). Parmi les initiatives figurent notamment la démarche référentiel carbone, qui permet de mesurer les émissions des structures culturelles labellisées et de les accompagner dans leur décarbonation collective, ainsi que le CACTÉ (obligatoire pour toutes les structures ayant signé un document de contractualisation de trois ans ou plus avec le ministère), conçu pour soutenir les acteurs de la création grâce à une série d’outils et faciliter le dialogue avec les partenaires financiers pour l’élaboration d’une stratégie partagée.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, les aides à la production du CNC pour les œuvres en prise de vue réelle sont soumises à la remise d’un bilan prévisionnel puis définitif des émissions carbones de la phase de production de l’œuvre. Depuis le 1er mars 2025, cette obligation a été étendue aux œuvres numériques type jeux vidéo et animations. Les œuvres immersives sont-elles les prochaines à l’agenda ? Pas encore, partage Leslie Thomas, secrétaire générale du CNC en charge de la politique écoresponsabilité. “Pour l’instant, nous n’avons pas d’outil à maturité pour mesurer l’impact de la création immersive.” La construction de ces obligations nouvelles se font main dans la main avec les acteurs du secteur, explique la secrétaire générale. “Au moment où on s’est intéressé aux films d’animation ou aux jeux vidéo, les syndicats du secteur avaient déjà entamé une réflexion et financé le démarrage d’un outil.”
Ces considérations environnementales sont pourtant bien présentes dans le secteur de l’immersif. En 2022, Landia Egal et Amaury La Burthe, tous les deux professionnel·les de la XR, s’intéressent à l’impact de leurs activités. “On s’est rendu compte qu’il n’y avait aucune donnée, se rappelle Landia Egal. On ne connaissait pas l’impact environnemental de la fabrication des casques, des réseaux, des datacenters. Il n’y avait pas d’évaluation, ni du présent, ni des scénarios futurs potentiels.” Via le plan France 2030 Alternatives vertes, ils obtiennent les fonds nécessaires pour faire appel à des experts du domaine comme Marie-Véronique Gauduchon, spécialiste des bilans carbones, Benoît Ruiz, consultant bas-carbone spécialiste des ICC, Benjamin Ninassi, responsable du programme “Numérique et Environnement” à l’INRIA ou encore les équipes du Shift Project. En février 2024, le groupe a publié CEPIR, Cas d’Étude pour un Immersif Responsable (CEPIR), l’une des études les plus approfondies sur le sujet de l’empreinte carbone du secteur immersif.
Pour des raisons de ressources, CEPIR se concentre sur la réalité virtuelle (VR). Le constat des analyses de cycle de vie (ACV) est alarmant. Pour fabriquer un casque VR et ses deux manettes, près de 281 kg de matières premières (extraction de ressources minérales et métalliques et énergie fossile) sont nécessaires, “soit 333 fois son poids final”, s’alarme le rapport. La fabrication de ce même ensemble consomme environ de 100 m3 d’eau, soit l’équivalent de la consommation annuelle de deux français, et 27 litres de pétrole en moyenne, soit l’équivalent CO2 de 350 km en voiture. Sans compter que les générations de casques se succèdent et ouvrent la porte à d’autres technologies pour favoriser l’immersion : ordinateurs sac à dos, tapis de course multidirectionnels, caméra VR 360°C (8 objectifs au lieu d’un), équipements de retours haptiques, etc., soulignent les auteurs·rices.
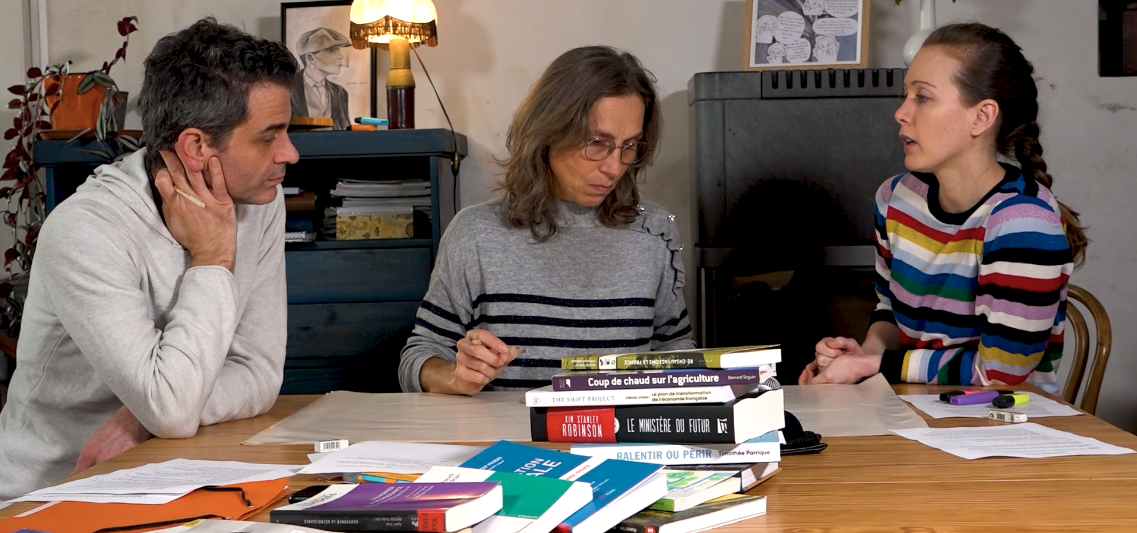
Les autres technologies – vidéos mapping, dômes, … – n’ont pas été intégrées à l’étude. Idem pour l’intelligence artificielle, qui n’avait pas encore connu l’explosion des LLM et des générateurs d’images au moment du lancement de l’étude. Or il faudrait que ces technologies, incontournables dans le domaine de la création immersive, puissent être analysées et intégrées à une large étude. La question demeure d’autant plus structurelle qu’une telle étude ne peut être soutenue que par des financements publics : à ce titre l’appel à projet “Alternatives Vertes 3” du plan France 2030, qui était annoncé pour la fin d’année 2024, ne verra vraisemblablement sans doute jamais le jour. C’eut été une occasion parfaite pour avancer sur une étude élargie du secteur.
Pour évaluer l’ampleur de son impact, le nerf de la guerre est le calculateur. CEPIR avait déjà esquissé un premier calculateur pour la XR, qui n’a finalement pas été poussé auprès de la communauté de la création artistique, faute de moyens humains. Du côté du CNC, qui a déjà homologué plusieurs calculateurs pour le cinéma, les étapes sont claires : définir un cahier des charges, puis homologuer ou non les outils de calcul développés par les différents acteurs, en conversation avec les experts du domaine. Les calculateurs permettent d’établir une sorte de moyenne par secteur, d’esquisser des trajectoires et de construire des stratégies pour baisser ces impacts, projette Leslie Thomas. Dans le monde du jeu vidéo, le Consortium National du Jeu Vidéo pour l’Environnement, regroupement informel d’acteurs du jeu vidéo intéressés par ces enjeux, a lancé Jyros, porté par l’association Game Only. Financé en partie via France 2030 Alternatives Vertes, le développement du calculateur a coûté environ 700 000 euros, estime Geoffrey Marmonier, porteur du projet. “Il a été compliqué d’obtenir des chiffres. Le jeu vidéo est une ICC entre deux mondes : il est souvent oublié des rapports sur la culture ou est noyé dans le numérique global.” Quelques personnes s’intéressent tout de même au sujet, comme le chercheur australien Ben Abraham. Selon lui, le secteur émettrait entre 40 et 50 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an, soit l’équivalent des émissions annuelles d’un pays comme la Norvège ou la Suisse.
Développé avec le cabinet en transition I Care, Jyros intègre les différents scopes:

Quatre indicateurs sont donc pris en compte : les émissions de CO2 et le dérèglement climatique, l’impact sur les ressources abiotiques naturelles (matériaux minéraux), l’impact sur l’eau et l’énergie primaire.
Pour le moment, l’éco-conditionnalité n’est qu’une obligation de fournir des bilans. L’obligation de résultat n’est pas envisagée par le CNC, assure Leslie Thomas. D’abord, les calculs, complexes, ne sont jamais d’une précision absolue, reconnaît la secrétaire générale. Surtout, “nous sommes sur une économie du prototype, il n’y a pas de structure commune, les œuvres sont très différentes les unes des autres en termes de coûts et d’envergures. On peut difficilement comparer une œuvre à une autre.” Le CNC choisit plutôt une logique incitative. En mai 2025, à l’occasion du festival de Cannes, il annonçait une prime RSE+ d’un montant forfaitaire de 28 000 euros pour les productions en prises de vue réelles les plus responsables.
Si l’éco-conditionnalité n’est pas (encore) à l’ordre du jour pour l’immersif, les acteurs du secteur se préparent-ils ? “Ça dépend, répond Landia Egal. Il y a des acteurs·rices de la filière sensibilisé·es et prêt·es à prendre des positions courageuses et faire les changements nécessaires. Mais ce n’est pas du tout la majorité.” Les auteurs·rices de CEPIR ont testé leurs confrères et consœurs sur leur niveau de connaissances et d’inquiétudes vis-à-vis des enjeux environnementaux. “La réponse de pas mal de professionnel·les est qu’ils ont déjà assez de problèmes sans ajouter ces considérations. La période est instable et il faut avoir le luxe de faire un pas de côté pour s’intéresser à ces sujets-là.” Geoffrey Marmonier acquiesce : “La majorité des studios sont des TPE ou PME. Ils n’ont pas de département RSE et les personnes en charge sont le·la patron·ne du studio, le département RH, les offices managers… des gens qui ont d’autres priorités. Dans un moment où le jeu vidéo est en crise, l’écologie passe souvent au second plan.” On retrouve également cette même composition du tissu de TPE ou PME dans le domaine de la création XR.
Il faudra pourtant bien s’y mettre. En plus des exigences de calcul de la CNC – financeur public comme peuvent l’être d’autres institutions – la question est aussi de savoir comment les financeurs privés, c’est-à-dire les producteurs, les banques ou les assurances vont aligner leur soutien à l’obligation de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Cette directive européenne, bien que fragilisée par des réformes en cours, impose aux grandes entreprises de publier un rapport annuel sur leur performance en matière de développement durable. L’objectif est de renforcer la transparence sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Dans le domaine du cinéma, les grands financeurs ayant déjà amorcé des engagements ESG contraignent déjà les productions à certaines obligations environnementales pour obtenir les fonds nécessaires. L’éco-conditionnalité pourrait donc venir de la réglementation via la finance, c’est en tout cas le pari de Flying Secoya. Cette plateforme permet aux professionnels de l’Entertainment (XR compris) de déployer une démarche bas carbone et d’accéder aux exigences des partenaires financiers.
Quoi qu’il en soit, même si l’éco-conditionnalité de la création immersive est encore loin d’une mise en application concrète, peut-être faut-il voir les choses sous un autre regard : Geoffrey Marmonier, estime ainsi que la transition écologique du secteur de la création immersive, “est une question de survie”. Si un jour on en vient à faire des arbitrages de matériaux ou d’usages électriques, ni le jeu vidéo ni l’immersif ne seront prioritaires. “il faut anticiper.” En matière d’écologie, une constante demeure : mieux vaut prévenir que guérir !
Elsa Ferreira